Partager la publication "La sociocratie ou l’émergence d’une gouvernance 3.0 (partie 2/2)"
Nous voici de nouveau à l’aube d’une révolution dans la façon de prendre des décisions au sein d’une organisation ou d’élire des responsables appréciés et soutenus par l’ensemble des personnes qui les ont nommés. Bon, j’avoue que cette intro fait un peu mauvais teaser d’un film d’anticipation de série Z. Pourtant, ceux qui vivent l’expérience de la sociocratie vous diront tous que leur réalité n’est pas si éloignée que ça de mon délire introductif.
La dernière fois nous avions vu les deux premiers piliers de la sociocratie, à savoir la présence du cercle de concertation et le principe de l’élection sans candidat. Voyons donc dans ce nouvel article, le reste des piliers fondateurs de la sociocratie : le consentement et le double lien. Je terminerai ensuite par les avantages et inconvénients de cette méthode de gouvernance 3.0
3- Le consentement
C’est mon préférée 🙂
À la différence du consensus qui requiert l’approbation de tous les membres d’un groupe sur une proposition, le consentement en sociocratie demande que tous les membres du cercle ne ressentent plus le besoin de s’opposer à cette même proposition.
La différence est subtile, je vous l’accorde, mais elle change tout du point de vue relationnel entre les membres du cercle. En effet, les groupes humains sont ainsi faits qu’il y en a souvent (pour ne pas dire toujours) quelques-uns qui parlent mieux, plus fort ou se montrent plus convaincants pendant que d’autres sont un peu plus sur la réserve, n’osent pas forcément partager leur point de vue et finissent par se rallier “au plus grand nombre”. Au final, même si une décision a été prise, elle n’est QUE la décision de ceux qui parlent mieux, plus fort ou se montrent plus convaincants. Les autres repartent avec une charge émotionnelle négative qui, tôt ou tard, se transformera en grain de sable venant gripper les rouages du système (frustration, démotivation, démission, sabotage, comportement passif-agressif, jalousie, etc.)
La question légitime que vous pourriez alors vous poser est la suivante : « comment est-il possible d’obtenir le consentement d’un groupe humain qui, par définition, est composé de multiples individualités ? »
Bon, vous ne vous l’êtes pas forcément posée comme ça, mais l’idée est là.
Quelques prérequis sont, en effet, indispensables :
- L’existence d’un projet commun
Le groupe en question doit être connecté à une Vision (ce qu’il apporte comme valeur ajoutée au monde qui l’entoure) et à une Mission (ce qu’il réalise pour accomplir sa vision). Le projet de ce groupe doit correspondre au projet de tous les membres du groupe. Si c’est le projet d’une seule personne (le dirigeant… ou celui qui parle mieux ou plus fort que les autres 😉 ), les dés sont pipés à la base. Le truc ne fonctionnera pas ou mal. Pour l’exemple, dans notre antenne associative, nous avions tous le projet commun de désigner le prochain président, en lien avec une vision et une mission construite il y a quelques années.
- Les propositions sont clarifiées
Après qu’une première proposition de décision soit soumise par l’un des membres du cercle, l’idée est de demander aux autres membres s’ils ont besoin de clarifier le contenu de cette proposition. Si oui, une question de clarification est posée à celui ou celle qui a émis la proposition afin d’apporter un éclairage supplémentaire. Cela évite les principaux pièges de la communication : les interprétations, distorsions et autres omissions.
- Les objections aux propositions sont argumentées
Une fois la proposition suffisamment claire et explicite pour tout le monde, il est temps de laisser la place aux objections. Ceci dit, dire non pour dire non est aussi utile que faire avancer une charrue avec des roues carrées. Certains sont maîtres en la matière et sont malheureusement enfermés dans un fonctionnement rigide et archaïque dont l’issue la plus probable, après avoir traversé tous les jeux psychologiques qui existent, est le statu quo, les chaises renversées et les portes qui claquent.
Argumenter son objection permet, dans un premier temps, de mettre de la conscience sur les éléments qui font que la proposition ne nous convient pas. Cela demande d’être à l’écoute de ses besoins, d’identifier ses valeurs et ressentir quand le tout est aligné… ou pas. C’est aussi savoir partager son ressenti avec le cercle, en toute responsabilité, en parlant avec le “Je” plus qu’avec le “Tu”. Ainsi, argumenter n’est pas convaincre; ce qui peut parfois être difficile pour certains, surtout quand le sujet leur tient à cœur.
- Les objections aux propositions sont traitées
Traiter une objection revient à enrichir la proposition à laquelle elle se rattache pour en fournir une sorte de “version 2.0”. C’est un peu comme les patchs de mise à jour des logiciels et applications. Il s’agit donc de proposer, après argumentation et en fonction de ses propres critères, valeurs et besoins, une nouvelle proposition qui sera à son tour soumise à la règle du consentement. Le jeu continue jusqu’à ce que le consentement soit effectif. La proposition pourra alors se transformer en décision validée par le cercle.
Ce qui est remarquable parfois avec ce processus, c’est qu’une proposition initiale pourra passer par plusieurs versions, pour finalement revenir à son contenu d’origine… mais avec un tout autre sens. En effet, elle sera enrichie de tous les arguments et évolutions des précédents échanges entre les membres du cercle et aura finalement une portée et une intégration complètement différente.
4 – Le double lien
Enfin, le dernier pilier de ce mode de gouvernance qu’est la sociocratie est l’existence d’un double lien; dans une organisation où plusieurs cercles existent à différents niveaux de gouvernance, le double lien signifie qu’un cercle est relié au cercle immédiatement supérieur par au moins deux personnes; le responsable et un membre délégué.
Pour l’exemple, la gouvernance nationale de notre association, qui fonctionne aussi en mode sociocratique, accueille en son sein, notre présidente d’antenne actuelle ainsi qu’une autre personne préalablement déléguée à cette fonction.
La sociocratie : avantages et inconvénients
Comme je le laissais entendre dans le précédent article, la sociocratie n’est pas l’ultime méthode qui fera que la Terre sera rebaptisée Utopia l’année prochaine. Elle ne peut donc pas être applicable partout et tout le temps. Voici un résumé des principaux avantages et désavantages identifiés de ce mode de gouvernance.
-
Avantages de la sociocratie
Elle augmente l’efficacité des réunions tout en diminuant leur nombre
Le taux d’absentéisme et de présentéisme est réduit
Elle améliore le contrôle des coûts et le service à la clientèle
Elle joue un rôle non négligeable dans la prévention des RPS (Risques Psychosociaux)
Elle encourage l’autodiscipline
Elle améliore le leadership entre pairs
Elle facilite la continuité organisationnelle
-
Inconvénients de la sociocratie
La sociocratie demande une planification méthodique de son déploiement au sein d’une organisation
Les décisions peuvent demander un peu plus de temps pour être validées
Elle nécessite la formation du personnel à de nouveaux concepts
Elle peut soulever des réactions émotives liées au changement, au pouvoir, à la responsabilité et à l’objection argumentée
Elle peut aussi générer de l’inconfort chez ceux qui ne sont pas habitués à prendre la responsabilité de participer à des décisions difficiles.
Pour conclure
Nous voici arrivés au terme de cette présentation sommaire sur la sociocratie. Cette gouvernance dynamique renferme encore bon nombre de trésors cachés qui ne demandent qu’à être découverts. Pour ça, rien de mieux que l’expérimentation.
Au sein de l’antenne associative dont je fais partie, nous sommes convaincus de son potentiel et l’expérimentons à chaque fois avec enthousiasme et plaisir.
Pensez à partager cet article avec vos amis sur les réseaux…
Source :
http://www.sociocratie.net/
http://www.sociocratie-france.fr/
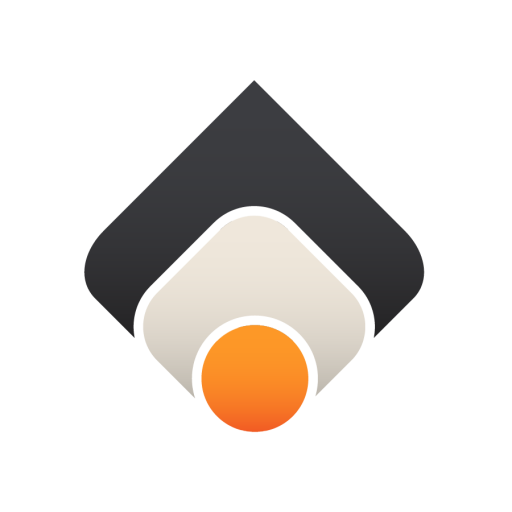

Merci pour votre article. J’ai particulièrement apprécié votre tableau avantages/inconvénients. Bien à vous.
Merci pour votre commentaire.
Je suis heureux de voir que la sociocratie vous intéresse.
Je voudrais attirer l’attention sur trois choses:
1) La sociocratie, notamment la holacratie, n’est plus simplement une méthode de management. Elle est employés par des entreprises de tout type (Ex: SCIC Scarabée Biocoop, Association Tousélus, etc…) mais aussi par des écoles dites « démocratiques » (Ex: Atelier des possibles).
2) Certains politiciens proposent le remplacement de la décentralisation ou du fédéralisme par la holacratie ou une autre forme sociocratie (Ex: Jacques Attali). Dans « Vivre autrement », un célèbre traité sur les communautés intentionnelles, Diane Leafe Christian recommande la sociocratie comme mode d’organisation interne de la communauté et l’on voit bien comment des communautés intentionnelles appliquant le même manifeste pourrait se fédérer selon le principe de la holacratie ou tout autre forme de sociocratie. Comprendre les avantages et défauts des différentes variantes de la sociocratie, ainsi que les astuces pour les pratiquer avec fruit devient essentiel sous différentes perspectives.
3) Pour corriger certaines carence de la sociocratie, on peut codifier son fonctionnement dans une charte inspirée constitution de la holacratie, la version 4.1 de préférence. L’idée consisterait à supprimer toute référence à la raison d’être de l’organisation, aux tensions et au formalisme qui y est lié (réunion de triage, etc…) et constituer des cercles chapauté par un premier lien, un second lien, un secrétaire et un facilitateur. La charte serait interprétée par les secrétaires, sans pouvoir contrevenir aux interprétations des secrétaires des super-cercles. Le facilitateur garantit le respect de la charte en dénonçant les infractions à qui de droit. Par ailleurs, les facilitateurs et secrétaires allègent la charge des liens qui peuvent alors se concentrer sur la stratégie.
Bonjour Philippe
Merci pour votre commentaire qui enrichit considérablement cet article.
Les lecteurs apprécieront.